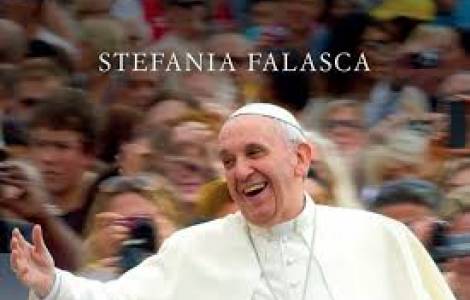
par Stefania Falasca*
Nous publions de larges extraits du chapitre consacré à la mission dans le livre de Stefania Falasca « Papa Francesco. La Viva maestra » (Edizioni San Paolo, 2025). L'ouvrage retrace le parcours essentiel suivi par le Magistère du Pape François au cours des années de son pontificat (2013-2025).
Rome (Agence Fides) – La mission renouvelée souhaitée par le Concile Vatican II se réalise de manière élémentaire : d'abord par la rencontre, puis par la parole, car l'annonce de l'Évangile est le témoignage vécu de l'amour miséricordieux de Dieu.
Cela ne pouvait donc être que la première des voies principales du Concile que le Pape François a voulu reprendre dans son magistère. C'est la voie principale qui mène au centre de ses enseignements, mais aussi au cœur même de la transmission de la foi aujourd'hui. Une voie qui, depuis la première exhortation Evangelii gaudium, en passant par les catéchèses papales des audiences générales consacrées à la redécouverte de la « passion pour l'évangélisation » aux sources du « zèle apostolique », est toujours là pour recommencer, pour indiquer ce qui est d'une importance vitale, ce qui anime et constitue l'identité même de l'Église. C'est la voie : la mission, « l'oxygène de la vie chrétienne ».
L'annonce de l'Évangile « n'est pas une option ou un aspect marginal », mais « une dimension vitale, car l'Église est née apostolique et missionnaire ». La mission, répète donc le Pape François, « est l'oxygène de la vie chrétienne, qui sans elle tombe malade, se dessèche et devient laide, très laide ». Et François a toujours repris les éléments essentiels pour l'Église qui naît missionnaire et est appelée à être témoin de l'annonce du salut du Christ :
« Notre annonce commence aujourd'hui, là où nous vivons. Et elle ne commence pas en essayant de convaincre les autres, non pas en convainquant, mais en témoignant chaque jour de la beauté de l'Amour qui nous a regardés et nous a relevés. Et c'est cette beauté, le fait de communiquer cette beauté, qui convaincra les gens, non pas nous, mais le Seigneur lui-même. Nous sommes ceux qui annoncent le Seigneur, nous ne nous annonçons pas nous-mêmes, ni un parti politique, ni une idéologie ».
Cette affirmation dit tout. Elle explique ce qu'est la mission, d'où elle jaillit, quelle est sa dynamique et comment elle se poursuit aujourd'hui.
Au cours de son pontificat, le Pape François a donc accordé une attention particulière à cette dimension vitale de la nature ecclésiale de l'œuvre apostolique, en puisant principalement dans les sources de l'Écriture et suggérant à chaque occasion que la mission ne concerne pas des spécialistes, des sujets ecclésiaux sélectionnés, car ses mouvements puisent au cœur même du mystère du salut et ses chemins concernent la foi de l'Église dans l'histoire du monde.
Et trois points clés sont constamment repris dans son enseignement concernant la mission.
Premièrement : « Sans Lui, nous ne pouvons rien faire », comme l'affirme François dans le texte de référence sur la mission, sur ce que signifie aujourd'hui dans le monde la mission d'annoncer l'Évangile. Il l'a répété à plusieurs reprises, notamment le 11 mai 2023, en recevant les membres de la Conférence des instituts missionnaires italiens :
« La mission est avant tout un mystère de grâce. La mission n'est pas notre œuvre, mais celle de Dieu ; nous ne la faisons pas seuls, mais mus par l'Esprit et dociles à son action ».
Ainsi, François a une fois de plus rappelé à toute l'Église quelle est la source vivante de toute œuvre apostolique. Et sa dynamique. Pour le Successeur des apôtres, l'expérience des apôtres est en effet un paradigme qui vaut pour toujours :
« Il suffit de penser à la manière dont les choses se déroulent gratuitement dans les Actes, sans contrainte... Il n'y a pas besoin de stratagèmes pour devenir annonciateurs de l'Évangile. Le baptême suffit. La mission, l'Église en sortie, ne sont pas un programme à réaliser par un effort de volonté. C'est le Christ qui fait sortir l'Église d'elle-même. La mission est son œuvre ».
(…).
Comme il l'a décrit dans un discours clé sur la mission adressé aux Œuvres Pontificales Missionnaires :
« Le salut, c'est la rencontre avec Jésus, qui nous aime et nous pardonne, en nous envoyant l'Esprit qui nous console et nous défend. Le salut n'est pas la conséquence de nos initiatives missionnaires, ni même de nos discours sur l'incarnation du Verbe. Le salut pour chacun ne peut se réaliser que par le regard de la rencontre avec Celui qui nous appelle. C'est pourquoi le mystère de la prédilection commence et ne peut commencer que dans un élan de joie, de gratitude »
Deuxièmement : « On ne peut évangéliser sans témoignage ». L'annonce de l'Évangile « est plus qu'une simple transmission doctrinale et morale ». Annoncer l'Évangile « est avant tout le témoignage d'une rencontre personnelle avec Jésus-Christ ». C'est pourquoi le témoignage du Christ est « le premier moyen de l'évangélisation » et « une condition essentielle pour son efficacité ». Dans sa catéchèse, il a repris de nombreuses citations de l'Exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi, le texte magistral de Paul VI défini par le Pape François comme la « Magna Carta de l'évangélisation dans le monde contemporain [...] toujours d'actualité, comme si elle avait été écrite hier ».
Les points saillants et les accents mis par la catéchèse papale ont souligné combien les paroles de Paul VI, dans Evangelii Nuntiandi, semblent aujourd'hui de plus en plus prophétiques lorsqu'il reconnaît que « l'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres », ou « s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins ». Le témoignage, a poursuivi l'évêque de Rome, comprend également la « foi professée » et se manifeste surtout dans le changement que le Christ lui-même opère dans ses témoins, dans ceux qui, précisément dans ce changement, rendent témoignage à Lui. C'est la foi « qui nous transforme, qui transforme nos relations, les critères et les valeurs qui déterminent nos choix ». C'est pourquoi, a fait remarquer l'évêque de Rome, le témoignage ne se manifeste pas comme une « prestation » exhibée par les témoins, mais représente plutôt le reflet d'un « chemin de sainteté » qui puise à la source sacramentelle du baptême, se réalise lui aussi comme « un don de Dieu » et « demande à être accueilli et mis à profit pour nous et pour les autres ».
Troisièmement : c'est le point clé sur lequel il a souvent insisté dans ce contexte : « La mission de l'Église n'est pas le prosélytisme ». La mission « n'est pas une affaire ou un projet d'entreprise, ni une organisation humanitaire. La communauté des disciples de Jésus – a déclaré le Pape François – est missionnaire par nature, et non prosélyte », car « être missionnaire, être apostolique, évangéliser, ce n'est pas la même chose que faire du prosélytisme. C'est le Saint-Esprit qui en est l'auteur, et non un effort humain de conquête ».
Au début du cycle de catéchèse sur l'évangélisation, il a donc repris l'expression utilisée par le pape Benoît XVI le 13 mai 2007 à Aparecida, dans son homélie lors de la messe inaugurale de la Ve Conférence générale de l'épiscopat latino-américain :
« L'Église ne fait pas de prosélytisme. Elle se développe plutôt par attraction. On ne suit pas le Christ, et encore moins on devient ses annonciateurs et ceux de son Évangile, par une décision prise à froid, par un élan personnel très actif, mais par attraction amoureuse. L'attraction se retrouve dans la dynamique de toute œuvre apostolique authentique, dans tout acte missionnaire authentique ».
Il ne s'agit donc pas d'efforts ou d'opérations cosmétiques visant à rendre l'image de l'Église plus « attrayante » ou à gagner des suffrages grâce à des stratégies de marketing. L'attrait évoqué par le Pape François est une prérogative des vivants. C'est celui que le Christ lui-même, le Ressuscité, peut exercer aujourd'hui sur le cœur de ses apôtres, de ses missionnaires, et même de ceux qui ne le cherchent pas. C'est pourquoi, tout au long de sa prédication, il a clairement mis en évidence la supercherie du prosélytisme qui distingue les missionnaires authentiques des recruteurs d'adeptes qui veulent se passer du Christ.
Pour le Pape François, « il y a prosélytisme partout où l'on cherche à faire croître l'Église sans l'attraction du Christ et l'action de l'Esprit, en misant tout sur un discours quelconque ». Ainsi, tout d'abord, le prosélytisme exclut de la mission le Christ lui-même et le Saint-Esprit, même lorsqu'il prétend parler et agir au nom du Christ. « Le prosélytisme est toujours violent, car il ne supporte pas la liberté et la gratuité avec lesquelles la foi peut se transmettre par la grâce, de personne à personne ». C'est pourquoi le prosélytisme, rappelle le Pape François, n'est pas seulement celui du passé, mais il peut aussi exister aujourd'hui dans les paroisses, les communautés, les mouvements, les congrégations religieuses. L'attraction, en revanche, est autre chose. Elle est le contraire du prosélytisme : « C'est un témoignage qui nous conduit à Jésus ». En résumé, ce que le Pape François désigne comme éternellement gagnant, c'est précisément cette dynamique toujours vivante de la mission, qui consiste à « se laisser guider par l'Esprit Saint : que ce soit Lui qui vous pousse à annoncer le Christ. Par le témoignage, par le martyre quotidien. Et si nécessaire, aussi par les mots ». (Agence Fides 4/5/2025).
*Écrivaine, Journaliste éditorialiste pour « Avvenire », Vice-présidente de la Fondation Vaticane Jean-Paul Ier